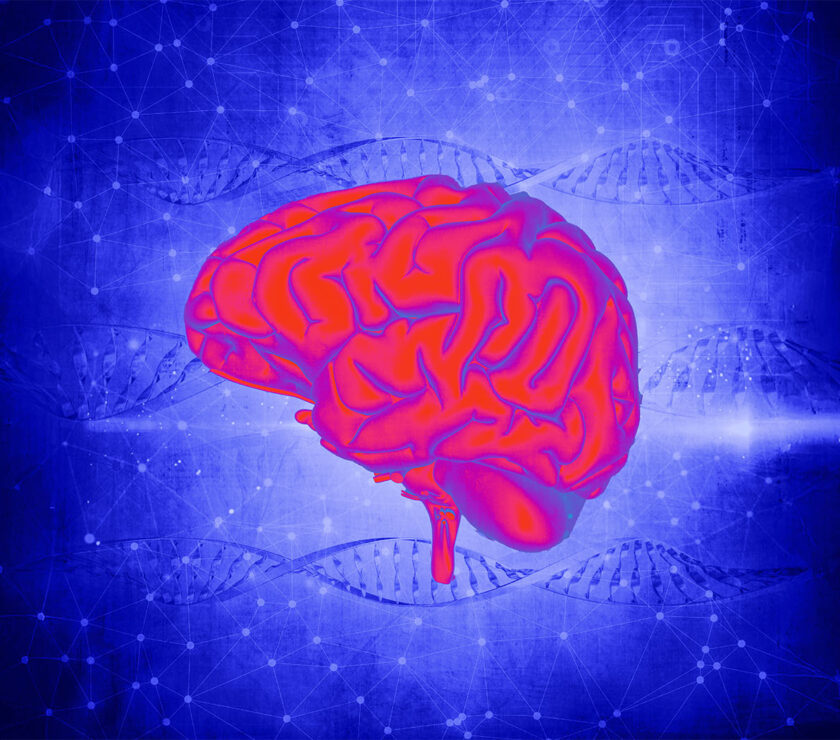Stratégies éducatives et professionnelles pour nourrir un moteur d’apprentissage durable
Cultiver la curiosité, c’est miser sur l’énergie motrice de l’apprentissage et de l’évolution. À l’heure où les compétences transversales et la capacité à s’adapter sont recherchées, miser sur la curiosité, c’est offrir à chacun la possibilité de s’épanouir, d’apprendre en continu et de façonner sa propre trajectoire dans un monde en changement.
Comment, alors, créer des environnements favorables à la curiosité ? Quelles pratiques peuvent transformer une simple envie de savoir en authentique moteur d’apprentissage ?
Dès l’enfance, la curiosité semble s’exprimer par le questionnement, l’imitation et l’envie d’explorer le monde. Selon la recherche, elle active des réseaux cérébraux liés à la récompense et à la mémoire, facilitant l’acquisition de nouveaux savoirs (revoir la publication neurosciences et curiosités). Les enjeux éducatifs, de formations et de développement des compétences, consistent à rendre pérenne cette dynamique : stimuler le désir d’apprendre, prévenir l’ennui ou le découragement, et valoriser le cheminement intellectuel plutôt que le seul résultat.
Faisons le point de pratiques éducatives et professionnelles pour nourrir la curiosité :
Apprentissage par projet
Exemple : Dans l’enseignement, un projet interdisciplinaire permet aux élèves d’explorer les thématiques de sujet proposé, de présenter leurs découvertes sous forme de podcast ou d’exposition.
Classe inversée et pédagogie du détour
Exemple : En formation professionnelle, les apprenants visionnent une vidéo sur les biais cognitifs avant le cours, puis débattent en petits groupes sur leurs implications dans leur métier.
Espaces d’exploration libre
Exemple : Dans une école primaire, un “coin des pourquoi” est installé : les élèves y déposent des questions, et chaque semaine, une question est explorée collectivement.
Utilisation de dilemmes ou de récits intrigants
Exemple : En début, la séance commence par une énigme qui sert de point d’entrée aux concepts.
Ateliers de résolution de problèmes réels
Exemple : En CAP maintenance, les formateurs proposent aux apprenants de diagnostiquer une panne sur un moteur inconnu.
Invités surprise ou “experts mystères”
Exemple : Un formateur invite un entrepreneur local sans annoncer son domaine. Les apprenants doivent deviner son activité à partir d’un échange libre.
Carnet de curiosité professionnelle
Exemple : Chaque apprenant note une question par semaine sur son métier ou secteur, à explorer en autonomie ou en groupe.
Journal de bord curieux
Exemple : Un lycée professionnel propose aux élèves en stage de noter chaque jour une chose qu’ils ne comprennent pas ou qui les intrigue dans l’entreprise.
Défi “pose une question”
Exemple : Chaque stagiaire doit poser une question à un professionnel chaque jour (sur son parcours, ses choix, ses outils).
Retour de stage en mode enquête
Exemple : Les jeunes présentent leur entreprise comme un “système” à décrypter : flux, rôles, interactions.
Brise-glace curieux
Exemple : En début de réunion, chaque participant partage une découverte récente (pro, perso, culturelle).
Réunion inversée
Exemple : Au lieu de présenter les résultats, le manager pose une question ouverte : “Qu’est-ce qui vous intrigue dans le fonctionnement du service ce mois-ci ?”
Exploration collective d’un sujet inconnu
Exemple : Une équipe RH explore ensemble les impacts de l’IA sur les métiers, chacun apportant une ressource ou une question.
Plus globalement, il s’agit de pratiques qui
- Mettent l’apprenant en situation de découverte
- Encouragent, valorisent le questionnement et le débat
- Favorisent la pédagogie active, engagent à l’action
- Utilise la surprise et la nouveauté
- Encouragent la lecture et la culture générale
- Génèrent des narrations vivantes (storytelling)
- Valorisent l’erreur et l’expérimentation
Dans le cadre de la formation professionnelle et de développement des compétences, des pratiques qui
- Créent un environnement d’apprentissage stimulant : la liberté d’explorer, remise en question, et expérimentation de nouvelles idées, méthodes ou outils
- Favorisent l’apprentissage continu : Propositions de formations variées, multimodales, des échanges avec des experts pour sortir de la routine et ouvrir l’esprit à la nouveauté
- Développent la réflexion critique : Incitation à poser des questions ouvertes, à remettre en question les idées reçues et à explorer différents points de vue
- Relèvent défis : usages de jeux pédagogiques, des outils ludiques, solutions immersives…
Cas particuliers : curiosité altérée ou atypique !
Relancer une curiosité absente ou réguler une curiosité excessive : quelques pistes
Dans le cas de curiosité inhibée
Les causes possibles sont l’anxiété, manque de confiance, environnement peu stimulant.
Pratiques adaptées pour stimuler la curiosité en cas d’absence de manifestation :
- Réaliser des Micro-défis personnalisés : proposer des tâches courtes et valorisantes.
Exemple : “Aujourd’hui, trouve une chose que tu ne savais pas sur l’IA.” - Mettre en place un Journal de curiosité : chaque apprenant/professionnel note une question ou une découverte par semaine.
- Instaurer du Mentorat ou tutorat bienveillant : créer un lien de confiance pour relancer l’envie d’apprendre.
- Créer le mystère et l’intrigue : Proposer des sujets inédits, poser des questions ouvertes, introduire de l’incertitude (quizz, énigmes) ou ne pas tout révéler d’un coup favorise la recherche de réponses et réveille la curiosité même chez les plus réticents.
- Relier l’apprentissage à des intérêts personnels :S’appuyer sur les passions, hobbies ou préoccupations du moment (actualités, jeux, films, centres d’intérêt) pour construire le contenu pédagogique rend le savoir plus attractif et concret.
- Valoriser la démarche exploratoire : Plutôt que donner les réponses, encourager la recherche individuelle ou en groupe, proposer un apprentissage “par le détour” (débats, études de cas, enquêtes).
- Mettre du sens dans les tâches : Expliquer en quoi une activité ou une compétence est utile dans la vie quotidienne. Trop souvent, le manque de curiosité provient d’une absence de compréhension de l’utilité réelle de l’apprentissage.
- Utiliser le jeu et le mouvement : Les activités ludiques et physiques (jeux de rôle, défis, manipulations) sont particulièrement utiles pour générer de l’engagement
Dans le cas de curiosité excessive ou dispersée
La curiosité est souvent présentée comme une force pour l’apprentissage. Pourtant, de nombreux élèves, apprenants, ou adultes « neuroatypiques » (TDAH, HPI, HPE) rencontrent des défis spécifiques : manque d’intérêt spontané, dispersion, voire sur motivation, exploration excessive conduisant à de l’épuisement ou à la frustration. Face à ces enjeux, des stratégies pédagogiques adaptées existent, permettant de (re)stimuler la curiosité ou de canaliser l’excès de motivation.
Pratiques adaptées activables :
- Fractionner les objectifs pour éviter la perte de contrôle et garder le cap.
- Réaliser des séquences courtes pour aider le maintien de l’attention et éviter la saturation
- Miser sur la routine et la structuration :
Instaurer des repères temporels et des habitudes stables pour apaiser les fluctuations motivationnelles et aider à canaliser l’énergie
- Faire varier les tâches : Proposer un éventail d’activités et alterner les types d’exercices pour réduire le risque de lassitude et favoriser une gestion saine de la stimulation intellectuelle.
- Faire prendre conscience des émotions.
Chez les HPE, HPI ou TDAH, le travail sur l’intelligence émotionnelle (identifier, nommer, réguler les émotions) via des outils concrets ou l’accompagnement thérapeutique améliore la gestion de la motivation et de l’attention.
- Encourager la coopération : Travailler en équipe ou en binôme permet de partager l’énergie, d’éviter la solitude dans l’engagement et d’apprendre à réguler les dynamiques motivationnelles.
Il n’existe pas de recette universelle pour relancer la curiosité ou gérer la motivation. Ce qui compte, c’est l’adaptation, la bienveillance et la compréhension du fonctionnement singulier de chacun. Les outils pédagogiques doivent rester flexibles, intégrant à la fois la valorisation de l’exploration et une structuration rassurante. Favoriser un équilibre entre le droit de s’ennuyer, le droit à l’intensité et la reconnaissance des rythmes individuels, c’est offrir à chaque apprenant la possibilité d’épanouir une curiosité solide et durable.
Cela interroge les postures !